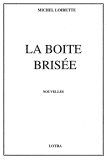LES FRAISES
Les congés de Pâques s'étaient, cette année là, achevés le 20 Avril, il avait fallu reprendre le chemin de Belmont-sur-Rance. La diligence d'Albi avait emmené les jeunes saint-affricains jusqu'au carrefour du Petit-Saint-Jean d'où il leur fallait encore accomplir une dizaine de kilomètres avant de parvenir au bourg et pénétrer dans les austères bâtiments du petit séminaire.
Le groupe qui avançait ce matin sur la route était composé de quatre jeunes gens, en blouse gris anthracite, le barda lourdement chargé sur l'épaule car près de trois mois s'écouleraient avant qu'ils ne revinssent dans leur famille. Leur paquetage comprenait les vêtements de change pour cette période.
Le trousseau aurait dû, réglementairement, être composé de deux gilets d'hiver en drap noir, de deux pantalons de laine, de deux gilets d'été, de deux vareuses en molleton, d'une casquette noire, de quatorze paires de bas ou de chaussettes, de dix-huit mouchoirs, de quatorze chemises, d'un veston et surtout d'une redingote en drap noir pour la remise des prix en fin d'année.
Trois paires de bottines lacées ou de brodequins avec talon large et plat, à bout suffisamment ample pour permettre le libre jeu des doigts de pied devaient compléter cette liste déjà longue et encore eût-il fallu ajouter quatre caleçons, un nécessaire de toilette, un sac à linge, quatre draps de lit et douze serviettes !
En réalité, ces jeunes gens issus d'un milieu très modeste ne disposaient que de l'indispensable, la direction du petit séminaire ayant accepté que leur trousseau fût réduit au strict nécessaire, soit, à quatre chemises en toile grossière, deux pantalons de laine et de simples brodequins de marche avec une paire de sabots, la casquette réglementaire leur avait été fournie par l'Econome et la vérité nous oblige à dire qu'ils ne disposaient pas de sous-vêtements, tout au plus protégeaient-ils leur ventre pendant les périodes les plus froides de l'hiver en l'enveloppant dans une bande de flanelle grise. Leur habillement était des plus frustes mais comme ils avaient bon appétit, ils emportaient avec eux tout ce qu'il fallait pour résister à la frugalité des repas car, par les temps qui couraient, la bonne chère se faisait rare au petit séminaire : une soupe, quelques haricots secs et, les jours de grandes fêtes, du lard avec un morceau de fromage; voilà tout ce que l'on servait dans le grand réfectoire glacé, après avoir dit force Notre Père et je vous Salue Marie. Les familles prenaient donc la précaution de donner, pour celles qui le pouvaient, un morceau de jambon séché dans le grenier, plusieurs mètres de saucisses, de la confiture de grattecul ou de la pâte de coing, produits redoutables en eux-mêmes parce qu'ils avaient l'inconvénient de constiper nos jeunes écoliers...mais avec quelques sachets de sulfate de soude on parvenait à débrider les intestins les plus paresseux, au prix, il est vrai, de coliques mémorables et pestilentielles!
Les garçons avaient à peu près le même âge : Antoine le fils du sabotier, Emile dont le père travaillait comme journalier dans une ferme, Pierre le fils du cantonnier et Marius dont les parents servaient comme domestiques dans la propriété d'un général, célébrité locale, parce qu'il appartenait, depuis peu au Grand Etat Major des Armées. Il faut souligner que ces événements se déroulent en 1917, aux pires moments de la grande guerre.
Pour comprendre la présence des quatre voyageurs séminaristes, il faut se replonger dans ce qui constituait le caractère profondément religieux du Rouergue de l'époque.
Après avoir accompli leur scolarité à l'Ecole Chrétienne des Frères de Saint-Affrique, ils avaient été envoyés au petit séminaire parce qu'ils avaient d'excellents résultats, en grec, en latin et en français, matières fondamentales pour qui voulait s'engager dans la prêtrise. L'école des frères, contrairement à celle des jésuites, était d'un coût modéré et permettait aux familles aux revenus modestes de scolariser leurs enfants dans une école autre que celle de la République dont chacun savait bien qu'elle n'avait d'autre vocation que de détourner les enfants de la sainte religion apostolique et romaine!... Les évêques de Rodez étaient alors à la tête de l'un des clergés les plus nombreux et les plus unis de France. En ce début de siècle, il y avait près de deux cents élèves au Grand Séminaire de Rodez, un millier de prêtres diocésains exerçaient leur sacerdoce, plusieurs centaines de religieux et de Frères enseignaient dans les Ecoles Chrétiennes.
On constatait bien une légère diminution des ordinations, due en grande partie à la séparation de l'Eglise et de l'Etat mais il y avait encore, tous les ans, de nombreux jeunes gens ordonnés prêtres au Grand Séminaire.
L'Aveyron contribuait de façon massive au recrutement de congrégations exerçant leur apostolat dans les lointaines colonies d'Afrique ou d'Extrême-Orient.
Le recrutement de jeunes était indispensable pour maintenir la tradition et c'est ainsi que, tous les ans, les responsables du petit séminaire passaient dans les classes des Ecoles Chrétiennes ou dans les familles pour susciter les vocations. Tous les garçons intelligents et travailleurs qui manifestaient quelque réussite à l'école étaient vivement encouragés à poursuivre leurs études au petit séminaire.
Les recrues étaient, dans leur immense majorité, d'origine populaire, et le plus souvent rurale. Cinq petits séminaires dont celui de Belmont alimentaient le grand séminaire. Il est certain que des raisons très matérielles favorisaient cette ferveur. Pour beaucoup de jeunes c'était le moyen d'échapper à la rude vie du champ ou de la ferme ou au travail encore plus pénible des mines de Decazeville ou d'Alès où ils devaient se résoudre à aller s'ils ne trouvaient pas d'emploi à la campagne... Ils savaient aussi que, contrairement à l'Ecole Normale qui contraignait ses maîtres à exercer comme instituteur lorsqu'ils avaient réussi le concours d'entrée, le petit et le grand séminaire ne les obligeraient jamais à devenir prêtre s'ils avouaient ne plus avoir la vocation. Après l'année de rhétorique, de nombreux séminaristes quittaient l'institution religieuse, s'inscrivaient dans un lycée public pour rejoindre, après le Baccalauréat, l'université de Toulouse ou de Clermont Ferrand et poursuivaient ainsi, de longues études que leur origine sociale ne leur eût pas permis d'entreprendre. Quant à l'engouement des familles pour la carrière religieuse, il s'explique, aisément, lorsque l'on sait que, dans ce pays de petits propriétaires et de modestes artisans, le secret espoir des parents était que certains de leurs enfants puissent renoncer à leurs droits à l'héritage sans trop en pâtir. Deux solutions se présentaient : le célibat ou le sacerdoce.
La lourde porte s'était refermée sur eux et ils s'étaient retrouvés avec leurs camarades dans le sombre dortoir qui dominait les bâtiments conventuels. De la fenêtre, ils apercevaient le jardin du Révérend Père Directeur; un potager de deux cents ares cultivé par l'homme à tout faire du séminaire qui y faisait pousser poireaux, choux et haricots selon les saisons. Toutefois, pour la première année, il y avait planté des fraisiers du Périgord qui donnent de gros fruits joufflus, au parfum pénétrant. Les plants de fraisiers avaient été soigneusement protégés des rigueurs des frimas par un paillage que l'on avait ôté aux premiers jours du printemps.
Les jours et les semaines s'écoulaient lentement, au rythme des devoirs et des leçons. Les réserves alimentaires données par les famille s'amenuisaient aussi. La nourriture de l'école d'exécrable devint tout à fait indigente, le cuisinier ayant dû encore réduire les portions de haricots secs et de lentilles servis quotidiennement à table alors que sous leurs yeux ils voyaient les fraises, jour après jour, devenir plus volumineuses, plus rubicondes et plus attirantes. Car pour ces jeunes gens qui avaient vécu leur enfance dans les champs où ils pouvaient à loisir cueillir les baies ou les drupes sauvages, la tentation était aussi grande que celle à laquelle fut soumis Tantale, le fils de Zeus lorsqu'il dut contempler les poires, les figues douces et les grenades à portée de sa main.
Une idée peu à peu germa dans leur tête. Le dortoir n'était pas particulièrement bien surveillé la nuit. Le maître d'internat était un vieux prêtre gâteux, ancien missionnaire qui avait trouvé refuge, ici, parce qu'il connaissait un professeur de l'établissement. A moitié sourd et souffrant de bronchite chronique il demeurait le plus souvent alité. Il n'était donc pas difficile de tromper sa vigilance. Le dortoir se trouvait au premier étage et il suffisait pour pénétrer dans le jardin des délices, de grimper sur un arbrisseau qui poussait le long d'un mur et de se laisser prudemment choir de l'autre côté. Le retour était moins facile car il fallait escalader le mur mais ce n'était pas un obstacle infranchissable car il comportait de nombreuses aspérités qui en facilitaient l'escalade. Des incursions dans le jardin avaient déjà eu lieu dans le passé, tout particulièrement pendant la saison des poires car un magnifique poirier trônait au milieu des légumes et les jeunes "voleurs" entourés d'une assemblée admirative contaient, le soir, leurs exploits, agrémentés, souvent, de prouesses imaginaires. Ainsi évoquaient-ils avec force détails l'arrivée subite du Concierge ou de l'Econome dont ils savaient déjouer la perspicacité. Il est vrai qu'aucun responsable de l'établissement ne s'était rendu compte du manège. Il faut préciser, sans sous-estimer leurs exploits, que le poirier était couvert de fruits et que la disparition de quelques kilos de poires ne pouvait que passer inaperçue.
L'expédition avait été savamment ourdie; nos trois garçons avaient choisi, après avoir consulté un calendrier, un jour sans lune, ce qui leur permettrait de passer inaperçus. Pour ne pas réveiller leurs camarades de chambrée, ils n'entreprendraient leur périple nocturne que vers deux ou trois heures du matin. Chacun fut investi d'une tâche particulière : Marius qui était le seul à posséder une montre, une grosse montre en argent, avec son nom gravé sous le couvercle et que son père lui avait offerte pour sa réussite au certificat d'études, serait ainsi chargé de réveiller ses camarades à l'heure dite. Antoine devrait faire le guet et Emile qui était le plus grand des trois ferait la courte échelle à Marius qui irait cueillir les fraises.
Nous étions un des premiers lundis de mai et, comme prévu, nos jeunes gens s'étaient réveillés vers deux heures du matin. D'ailleurs avaient-ils vraiment dormi avant l'heure fatidique? le dortoir comprenait une centaine de lits alignés mais nos trois amis étaient dispersés à travers la salle; il fallut marcher sur la pointe des pieds et ne réveiller personne; ils durent passer devant la chambre du surveillant et même si celui-ci était sourd et ronflait comme un bienheureux, il se faufilèrent le plus discrètement possible jusqu'à la porte. Quelques instants plus tard ils se retrouvaient dans la cour attenante. Tout se déroula comme convenu. et Marius qui était monté sur les épaules d'Emile réapparut bientôt au sommet du mur. Il avait soigneusement enveloppé les fraises dans un grand mouchoir à carreaux rouges dont il avait noué les extrêmités.
De retour au dortoir, ils avaient dissimulé le précieux butin sous leur lit et s'étaient endormis. La nuit fut courte car trois heures plus tard, le roulement du tambour retentissait. Il était 6h30 du matin et ils devaient comme tous leurs camarades accomplir leur toilette et effectuer des mouvements de gymnastique respiratoire. C'est au moment où il s'apprêtait à quitter le dortoir que Marius se rendit compte qu'il ne retrouvait plus sa montre. Après avoir fouillé fébrilement dans ses affaires, il dut convenir qu'elle avait bien disparu et qu'à n'en pas douter, elle avait dû s'échapper de sa poche lorsqu'il avait escaladé le mur. Comble de malchance, le nom gravé à l'intérieur l'identifiait inéluctablement.
La journée fut insupportable, à chaque instant, Marius s'attendait à voir surgir dans la salle de classe, le préfet des études, un homme long et sec, au visage fermé et au regard d'acier que les élèves craignaient pour la rigueur de ses sanctions. C'est en fin d'après-midi, alors que la classe traduisait un texte de Sophocle que le personnage tant redouté fit brutalement irruption. Dans un silence pesant, Marius s'entendit signifier qu'il devait, à la fin du cours se rendre dans le bureau préfectoral.
Le moment venu, Marius rangea ses affaires et se dirigea vers le fameux bureau; il fallait pour cela emprunter un couloir qui lui parut interminable et que les élèves n'utilisaient que pour des raisons graves. C'était le couloir de l'infamie, des pleurs et des grincements de dents; Marius était livide car il s'attendait aux pires sanctions. Quelques jours plus tôt, un élève qui avait eu le malheur de faire l'école buisonnière avait été renvoyé définitivement; pourtant, les raisons de son escapade auraient pu attendrir le cœur le plus endurci puisqu'il s'était résolu à partir au chevet de sa mère dont il venait d'apprendre l'état critique. Rien n'y fit, ni la maladie, ni même l'annonce quelques jours plus tard du décès de la pauvre femme.
Il frappa d'abord timidement mais n'entendant pas de réponse, recommença avec plus de hardiesse; il entendit alors comme dans un rêve ou plutôt un cauchemar, résonner cette interjection:" Entrez."
Le préfet classait des papiers et semblait se désintéresser de son visiteur. Il resta planté devant le bureau; ces minutes lui parurent durer une éternité. Au bout d'un moment, le préfet releva la tête et s'adressa au jeune homme sur un ton qui n'admettait pas la réplique :
* Je vous ai demandé de venir parce que le jardinier a trouvé ce matin dans le jardin du Révérend Père, cette montre qui, certainement, vous appartient puisque votre nom est gravé à l'intérieur. Pouvez-vous m'expliquer sa présence dans le jardin? et pouvez-vous me donner aussi la raison pour laquelle il ne reste ce matin plus aucune fraise. Ne répondez pas car je connais la réponse; vous vous êtes rendu coupable d'un vol et vous avez enfreint le règlement de l'établissement qui stipule très clairement qu'aucun élève n'a le droit de quitter le dortoir sans ordre du maître d'internat. Peut-être savez-vous ce qu'il en coûte à ceux qui ne respectent pas ce règlement? J'ai décidé, cependant, de vous donner une chance : je n'ignore pas que vous avez eu des complices pour pénétrer dans ce lieu, je vous demande donc de m'indiquer leur nom : faute de quoi, je vous demanderai de préparer votre baluchon, j'enverrai une lettre à vos parents pour leur donner la raison de votre renvoi et vous devrez quitter dans les plus brefs délais le petit séminaire.
Marius était livide, terrorisé, il imaginait déjà le désespoir de ses parents : le vol était dans un village l'infamie la plus grande qui pouvait être reprochée à un de ses habitants. C'était l'opprobre jeté sur toute la famille; il savait que ses parents voulaient qu'il devienne prêtre et cela remettait en cause définitivement ce projet .
* C'est la faute de Bourpiquel! s'exclama le jeune Marius, c'est lui qui a tout organisé.
Il n'est pas inutile de savoir qui était Bourpiquel. C'était un jeune paysan du village de Tiergues; bossu et doté d'un strabisme important, il compensait ces disgrâces physiques par une force peu commune, en un mot, c'était une sorte de Quasimodo sorti tout droit des tours de Notre-Dame-de-Paris. Comme il manifestait, malgré tout, quelque savoir, il fut décidé qu'il irait au séminaire et l'on priait dans sa famille pour qu'il y restât et qu'il devînt prêtre. Au pensionnat, c'était le souffre- douleur et bien souvent, il fut puni à la place de ses congénères. Il est vrai qu'il était dans tous les coups pendables, dans toutes les âneries que ces jeunes gens isolés pendant les longs mois d'hiver s'ingéniaient à inventer. Ainsi, est-ce lui qui avait été accusé de tirer les cloches à 2H du matin et de sonner le tocsin. En réalité, il se trouvait là avec d'autres garnements mais lorsque ceux-ci avaient entendu venir le bedeau époumonné et grondant, ils s'étaient tous enfuis et il s'était retrouvé seul grimpé en haut de la corde.
Une autre fois, on l'avait surpris à uriner dans les bouteilles d'encre et c'est lui bien entendu qui avait lâché en plein office un chat épouvanté avec une casserole attachée à la queue.
Bourpiquel fut convoqué, mis à la porte et l'on n'entendit plus jamais parler de lui au séminaire de Belmont. Marius en fut quitte pour la peur. Le préfet se contenta de lui faire recopier dix fois sa grammaire latine, ce qui lui prit toutes ses soirées jusqu'aux vacances d'été.
Les cours étaient à présent terminés et les jeunes séminaristes avaient repris le chemin de leur village. Marius devait retrouver ses parents dans la maison de l'oncle Emile.
Arrivé à la hauteur de Tiergues quelle ne fut pas sa surprise de rencontrer le jeune Bourpiquel qui menait un troupeau de moutons sur la route. Ce dernier ne manqua pas de le reconnaître et prononça en pâtois de terribles imprécations qui prouvaient qu'il n'avait pas oublié son renvoi du séminaire. Avant qu'il n'ait eu le temps de réagir, Marius reçut en plein visage un coup d'une si grande violence qu'il le laissa inerte sur le sol. Après être revenu à lui, il sentit sur son visage la moiteur gluante du sang et une douleur très vive sur l'arête du nez. Arrivé chez son oncle, il constata que son nez avait été brisé et lorsqu'il expliqua à sa famille les raisons de cet accident, il dut, pour ne pas évoquer l'affaire des fraises et de la montre parler d'une rencontre brutale avec une branche du chemin !
Chapitre 9...